Ce
livre pourrait être vu comme une sorte de manuel de survie pour
homme d’esprit dans un monde sans esprit. Car Schopenhauer, en
prodiguant ses conseils destinés à nous éviter les désagréments
et les malheurs de l’existence, ne cesse de comparer les nombreux
esprits communs aux quelques esprits éminents – pour reprendre sa
formulation –, et il met souvent en garde ces derniers contre les
premiers.
L’auteur,
comme à son habitude, est détaché de toute tentative de vouloir
plaire pour se faire bien voir. Seul compte pour lui l’honnêteté
intellectuelle, la lucidité, la franchise, la hauteur de vue de sa
pensée.
Un
livre quelque peu âpre mais plein de pertinence. Enfin !
Cela dépend pour qui. Car comme le dit Schopenhauer : « le
même événement qui se présente d’une façon si intéressante
dans la tête d’un homme d’esprit, n’offrirait plus, conçu par
un cerveau plat et banal, qu’une scène insipide de la vie de tous
les jours. »
Quelqu’un
doué d’un esprit supérieur – pour reprendre une autre
formulation de Schopenhauer –, et donc avant tout soucieux du vrai,
ne peut être que malmené par un monde, et surtout par une époque
comme la nôtre, car tout y est conçu pour le rabaisser, le
culpabiliser, pour qu’il se sente anormal, insuffisant, ridicule,
grossier, prétentieux.
Lorsqu’il
est encore jeune et désarmé d’expérience pour savoir enfin
fermement quoi penser de telles opinions, celles-ci, malgré le peu
d’estime qu’il leur accorde, provoquent souvent son abattement.
Il
ne conteste pas son orgueil, mais voit bien que la prétention qu’on
lui reproche est en réalité l’agacement provoqué par ses
qualités blessant la prétention de ceux lui reprochant d’être prétentieux.
Il
lui faut du temps pour passer du sentiment d’être inadapté aux
règles communes à cause de certains défauts ou de certaines tares,
au sentiment, puis à la certitude d’être inadapté à cause de
ses qualités et de ses dons.
Comme
le dit Schopenhauer : « C’est
un mauvais symptôme, au point de vue moral comme au point de vue
intellectuel, pour un jeune homme, de se retrouver facilement au
milieu des menées humaines, d’y être bientôt à son aise et d’y
pénétrer comme préparé à l’avance ; cela annonce de la
vulgarité. Par contre, une attitude décontenancée, hésitante,
maladroite et à contresens est, en pareille circonstance, l’indice
d’une nature de noble espèce. »
Voilà
tout Schopenhauer ! Son génie, du meilleur cru, lui permet de
tout remettre à l’endroit.
Il
montre que ce qui est admiré par tout le
monde, servi en exemple, est en réalité très souvent ce qu’il y
a de plus vulgaire. Comme il le dit lui-même : « D’une
manière générale, il est vrai que les sages de tous les temps ont
toujours dit la même chose, et les sots, c’est-à-dire l’immense
majorité de tous les temps, ont toujours fait la même chose, à
savoir le contraire, et il en sera toujours ainsi. Aussi Voltaire
dit-il : "Nous laisserons ce monde-ci aussi sot et aussi
méchant que nous l’avons trouvé en y arrivant." »
Bien
entendu, les esprits de qualité, comme l’explique Schopenhauer,
sont rares. Il ne faut donc pas voir toute personne inadaptée,
décalée, poussée à s’isoler, étrange et prétentieuse pour les
autres, incomprise, éthérée, idéaliste, mal dans sa peau,
désespérée, comme la chanceuse détentrice de qualités d’esprit
exceptionnelles, loin s’en faut !
Ce
livre peut cependant également être utile à des personnes n’ayant
pas un esprit supérieur, mais dont la personnalité, non dépourvues
de qualités, fait qu’elles subissent assez mal l’opinion ambiante bien-pensante
apparemment si sûre de sa valeur. Schopenhauer pourra leur être fort utile en leur donnant des clefs de lecture intemporelles qui leur permettront de savoir quoi penser de cette opinion.
Pour revenir aux esprits supérieurs, ce livre fera d’eux les spectateurs
complices, rassérénés, joyeux, et vengés, d’une puissante
tempête n’emportant sur son passage que les nombreux faux marbres.
On
peut adresser la critique suivante à Schopenhauer qui ne précise
pas que certaines de ses catégorisations et certains de ses
conseils, selon les personnes, peuvent admettre des adaptations
paradoxales, ou des nuances, comme il en admet d’ailleurs pour lui-même.
Par
exemple, il dit qu’un esprit parmi les meilleurs, ayant compris ce
qu’il y avait d’inepte et de malsain dans la société, finit généralement par s’isoler et vivre en ermite. C’est
peut-être souvent vrai, pourtant, lui qui se mettait dans cette
catégorie, cherchait la renommée, c’est-à-dire la reconnaissance
publique, qui ne conduit pas à un isolement complet.
Certes,
même si il recherchait la notoriété, il s’est néanmoins
effectivement retranché dans la création de son œuvre, et lui n’a
pas cherché à jouer le beau vertueux, le gentil bien intentionné,
pour provoquer une plus rapide mais niaise et vulgaire sympathie des
foules. Il rechercha donc la renommée, mais uniquement la renommée
méritée. Il n’en reste pas moins que rechercher la reconnaissance
publique est l’inverse de ce qu’il faut faire si on souhaite
vivre dans un isolement complet.
L’une
des qualités de cet auteur du XIXe siècle est qu’il ne peut être
lu sans que l’on se répète qu’il est décidément fréquemment
un excellent critique de notre époque.
L’égalitarisme ;
le fait de considérer que dans la vie IL FAUT être positif ;
la sociabilité ; l’envie constante de voyager et de se
divertir ; l’affairement incessant ; la poursuite de la
richesse. Signes de progrès, d’épanouissement, et de réussite
pour la grande majorité des gens. Signes de vulgarité d’esprit
pour Schopenhauer. Les extraits au bas de l’article vous montreront
en partie ce qu’il en pensait.
En somme, il plaçait au plus bas ce que nous appelons l’esprit petit-bourgeois, si répandu aujourd’hui. Cet esprit de confort, dans tous les domaines : confort matériel, intellectuel, moral, idéologique, social. Cet esprit "après moi le déluge", mesquin, jouisseur, mercantile, conformiste, poussant les petits-bourgeois à constamment adopter une posture bien-pensante, à être les ennemis médiocres et suffisants du recul sur soi.
Autant de "qualités" qui pour Schopenhauer participent à faire de ce monde une épreuve pour tout esprit supérieur.
On ne peut douter qu’il aurait souverainement détesté notre société de consommation politiquement correcte.
Autant de "qualités" qui pour Schopenhauer participent à faire de ce monde une épreuve pour tout esprit supérieur.
On ne peut douter qu’il aurait souverainement détesté notre société de consommation politiquement correcte.
« Combien
n’en voyons-nous pas, dans un affairement incessant, diligents
comme des fourmis et occupés du matin au soir à accroître une
richesse déjà acquise ! Ils ne connaissent rien par-delà
l’étroit horizon qui renferme les moyens d’y parvenir ;
leur esprit est vide et par suite inaccessible à toute autre
occupation. Les jouissances les plus élevées, les jouissances
intellectuelles sont inabordables pour eux ; c’est en vain
qu’ils cherchent à les remplacer par des jouissances fugitives,
sensuelles, promptes, mais coûteuses à acquérir, qu’ils se
permettent entre temps. Au terme de leur vie, ils se trouvent avoir
comme résultat, quand la fortune leur a été favorable, un gros
monceau d’argent devant eux, qu’ils laissent alors à leurs
héritiers le soin d’augmenter ou aussi de dissiper. Une pareille
existence, bien que menée avec apparence très sérieuse et très
importante, est donc tout aussi insensée que telle autre qui
arborerait carrément pour symbole une marotte.
Ainsi,
l’essentiel pour le bonheur de la vie, c’est ce que l’on a
en soi-même.
C’est uniquement parce que la dose en est d’ordinaire si petite
que la plupart de ceux qui sont sortis déjà victorieux de la lutte
contre le besoin se sentent au fond tout aussi malheureux que ceux
qui sont encore dans la mêlée. Le vide de leur intérieur,
l’insipidité de leur intelligence, la pauvreté de leur esprit les
poussent à rechercher la compagnie, mais une compagnie composée de
leurs pareils, car similis
simili gaudet.
Alors commence en commun la chasse au passe-temps et à l’amusement,
qu’ils cherchent d’abord dans les jouissances sensuelles, dans
les plaisirs de toute espèce et finalement dans la débauche. La
source de cette funeste dissipation, qui, en un temps souvent
incroyablement court, fait dépenser de gros héritages à tant de
fils de famille entrés riches dans la vie, n’est autre en vérité
que l’ennui résultant de cette pauvreté et de ce vide de l’esprit
que nous venons de dépeindre. Un jeune homme ainsi lancé dans le
monde, riche en dehors, mais pauvre en dedans, s’efforce vainement
de remplacer la richesse intérieure par l’extérieure [...] »
« [...]
ce vide
intérieur qui
se peint sur tant de visages et qui se trahit par une attention
toujours en éveil à l’égard de tous les événements, même les
plus insignifiants, du monde extérieur ; c’est ce vide qui
est la véritable source de l’ennui et celui qui en souffre aspire
avec avidité à des excitations extérieures, afin de parvenir à
mettre en mouvement son esprit et son cœur par n’importe quel
moyen. Aussi n’est-il pas difficile dans le choix des moyens ;
on le voit assez à la piteuse mesquinerie des distractions
auxquelles se livrent les hommes, au genre de sociétés et de
conversations qu’ils recherchent, non moins qu’au grand nombre de
flâneurs et de badauds qui courent le monde. C’est principalement
ce vide intérieur qui les pousse à la poursuite de toute espèce de
réunions, de divertissements, de plaisirs et de luxe, poursuite qui
conduit tant de gens à la dissipation et finalement à la misère.
Rien
ne met plus sûrement à l’abri de cette misère que la
richesse intérieure,
la richesse de l’esprit, car celui-ci laisse d’autant moins de
place à l’ennui qu’il approche davantage de la supériorité.
L’activité incessante des pensées, leur jeu toujours renouvelé
en présence des manifestations diverses du monde interne et externe,
la puissance et la capacité de combinaisons toujours variées,
placent une tête éminente, sauf les moments de fatigue, tout à
fait en dehors de la portée de l’ennui. Mais, d’autre part, une
intelligence supérieure a pour condition immédiate une sensibilité
plus vive, et pour racine une plus grande impétuosité de la volonté
et, par suite, de la passion ; de l’union de ces deux
conditions résulte alors une intensité plus considérable de toutes
les émotions et une sensibilité exagérée pour les douleurs
morales et même pour les douleurs physiques, comme aussi une plus
grande impatience en face de tout obstacle, d’un simple dérangement
même. »
« L’homme
intelligent aspirera avant tout à fuir toute douleur, toute
tracasserie et à trouver le repos et les loisirs ; il recherchera
donc une vie tranquille, modeste, abritée autant que possible contre
les importuns ; après avoir entretenu pendant quelque temps des
relations avec ce que l’on appelle les hommes, il préférera une
existence retirée, et, si c’est un esprit tout à fait supérieur,
il choisira la solitude. Car plus un homme possède en lui-même,
moins il a besoin du monde extérieur et moins les autres peuvent lui
être utiles. Aussi la supériorité de l’intelligence conduit-elle
à l’insociabilité. Ah ! si la quantité de la société
pouvait être remplacer par la qualité, cela
vaudrait alors la peine de vivre même dans le grand monde : mais,
hélas ! cent fous mis en un tas ne font pas encore un homme
raisonnable. – L’individu placé à l’extrême opposé, dès
que le besoin lui donne le temps de reprendre haleine, cherchera à
tout prix des passe-temps et de la société ; il s’accommodera de
tout, ne fuyant rien tant que lui-même. C’est dans la solitude, là
où chacun est réduit à ses propres ressources, que se montre ce
qu’il a
par lui-même ;
là, l’imbécile, sous la pourpre, soupire écrasé par le fardeau
éternel de sa misérable individualité, pendant que l’homme
hautement doué, peuple et anime de ses pensées la contrée la plus
déserte. Sénèque (Ép. 9) a dit avec raison : « omnis
stultitia laborat fastidio sui (La
sottise se déplaît à elle-même) » ; de même Jésus, fils de
Sirach : « La
vie du fou est pire que la mort. »
Aussi voit-on en somme que tout individu est d’autant plus sociable
qu’il est plus pauvre d’esprit et, en général, plus vulgaire.
Car dans le monde on n’a guère le choix qu’entre l’isolement
et la communauté. »
« Et
tout d’abord toute société exige nécessairement un accommodement
réciproque, un tempérament : aussi, plus elle est nombreuse,
plus elle devient fade. On ne peut être vraiment
soi qu’aussi
longtemps qu’on est seul ; qui n’aime donc pas la solitude
n’aime pas la liberté, car on n’est libre qu’étant seul.
Toute société a pour compagne inséparable la contrainte et réclame
des sacrifices qui coûtent d’autant plus cher que la propre
individualité est plus marquante. Par conséquent, chacun fuira,
supportera ou chérira la solitude en proportion exacte de la valeur
de son propre moi. Car c’est là que le mesquin sent toute sa
mesquinerie et le grand esprit toute sa grandeur ; bref, chacun
s’y pèse à sa vraie valeur. En outre un homme est d’autant plus
essentiellement et nécessairement isolé, qu’il occupe un rang
plus élevé dans le nobiliaire de la nature. C’est alors une
véritable jouissance pour un tel homme, que l’isolement physique
soit en rapport avec son isolement intellectuel : si cela ne
peut pas être, le fréquent entourage d’êtres hétérogènes le
trouble ; il lui devient même funeste, car il lui dérobe son
moi et n’a rien à lui offrir en compensation. De plus, pendant que
la nature a mis la plus grande dissemblance, au moral comme à
l’intellectuel, entre les hommes, la société, n’en tenant aucun
compte, les fait tous égaux, ou plutôt, à cette inégalité
naturelle, elle substitue les distinctions et les degrés artificiels
de la condition et du rang qui vont souvent diamétralement à
l’encontre de cette liste par rang telle que l’a établie la
nature. Ceux que la nature a placés bas se trouvent très bien de
cet arrangement social, mais le petit nombre de ceux qu’elle a
placés haut n’ont pas leur compte ; aussi se dérobent-ils
d’ordinaire à la société : d’où il résulte que le
vulgaire y domine dès qu’elle devient nombreuse. Ce qui dégoûte
de la société les grands esprits, c’est l’égalité des droits
et des prétentions qui en dérivent, en regard de l’inégalité
des facultés et des productions (sociales) des autres. La soi-disant
bonne société apprécie les mérites de toute espèce, sauf les
mérites intellectuels ; ceux-ci y sont même de la contrebande.
Elle impose le devoir de témoigner une patience sans bornes pour
toute sottise, toute folie, toute absurdité, pour toute stupidité ;
les mérites personnels, au contraire, sont tenus de mendier leur
pardon ou de se cacher, car la supériorité intellectuelle, sans
aucun concours de la volonté, blesse par sa seule existence. En
outre, cette prétendue bonne société n’a pas seulement
l’inconvénient de nous mettre en contact avec des gens que nous ne
pouvons ni approuver ni aimer, mais encore elle ne nous permet pas
d’être nous-mêmes, d’être tel qu’il convient à notre
nature ; elle nous oblige plutôt, afin de nous mettre au
diapason des autres, à nous ratatiner pour ainsi dire, voire même à
nous difformer. Des discours spirituels ou des saillies ne sont de
mise que dans une société spirituelle ; dans la société
ordinaire, ils sont tout bonnement détestés, car pour plaire dans
celle-ci il faut absolument être plat et borné. Dans de pareilles
réunions, on doit, avec une pénible abnégation de soi-même,
abandonner les trois quarts de sa personnalité pour s’assimiler
aux autres. Il est vrai qu’en retour on gagne ces autres ;
mais plus on a de valeur propre, plus on verra qu’ici le gain ne
couvre pas la perte et que le marché aboutit à notre détriment,
car les gens sont d’ordinaire insolvables, c’est-à-dire qu’ils
n’ont rien dans leur commerce qui puisse nous indemniser de
l’ennui, des fatigues et des désagréments qu’ils procurent ni
du sacrifice de soi-même qu’ils imposent : d’où il résulte
que presque toute société est de telle qualité que celui qui la
troque contre la solitude fait un bon marché. À cela vient encore
s’ajouter que la société, en vue de suppléer à la supériorité
véritable, c’est-à-dire à l’intellectuelle qu’elle ne
supporte pas et qui est rare, a adopté sans motifs une supériorité
fausse, conventionnelle, basée sur des lois arbitraires, se
propageant par tradition parmi les classes élevées et, en même
temps, variant comme un mot d’ordre ; c’est celle que l’on
appelle le bon ton, « fashionableness ».
Toutefois, quand il arrive que cette espèce de supériorité entre
en collision avec la véritable, la faiblesse de la première ne
tarde pas à se montrer. En outre, « quand le bon ton arrive,
le bon sens se retire. » »
« Il
existe trois
aristocraties :
1° celle de la naissance et du rang ; 2° celle de l’argent ;
3° celle de l’esprit. Cette dernière est en réalité la plus
distinguée et se fait aussi reconnaître pour telle, pourvu qu’on
lui en laisse le temps : Frédéric le Grand n’a-t-il pas dit
lui-même : « Les
âmes privilégiées rangent à l’égal des souverains ? »
Il adressait ces paroles à son maréchal de la cour, qui se trouvait
choqué de ce que Voltaire était appelé à prendre place à une
table réservée uniquement aux souverains et aux princes du sang,
pendant que ministres et généraux dînaient à celle du maréchal. »
« Nul
ne peut voir par-dessus
soi.
Je veux dire par là qu’on ne peut voir en autrui plus que ce qu’on
est soi-même, car chacun ne peut saisir et comprendre un autre que
dans la mesure de sa propre intelligence. Si celle-ci est de la plus
basse espèce, tous les dons intellectuels les plus élevés ne
l’impressionneront nullement, et il n’apercevra dans cet homme si
hautement doué que ce qu’il y a de plus bas dans l’individualité,
savoir toutes les faiblesses et tous les défauts de tempérament et
de caractère. Voilà de quoi le grand homme sera composé aux yeux
de l’autre. Les facultés intellectuelles éminentes de l’un
existent aussi peu pour le second que les couleurs pour les aveugles.
C’est que tous les esprits sont invisibles pour qui n’a pas
soi-même d’esprit : et toute évaluation est le produit de la
valeur de l’estimé par la sphère d’appréciation de
l’estimateur.
Il
résulte de là que lorsqu’on cause avec quelqu’un on se met
toujours à son niveau, puisque tout ce qu’on a au delà disparaît,
et même l’abnégation de soi qu’exige ce nivellement reste
parfaitement méconnue. Si donc on réfléchit combien la plupart des
hommes ont de sentiments et de facultés de bas étage, en un mot
combien ils sont communs,
on verra qu’il est impossible de parler avec eux sans devenir
soi-même commun pendant
cet intervalle (par analogie avec la répartition de l’électricité) ;
on saisira alors la signification propre et la vérité de cette
expression allemande : « sich
gemein machen »
(se mettre de pair à compagnon, s’acoquiner), et l’on cherchera
à éviter toute compagnie avec laquelle on ne peut communiquer que
moyennant la partie
honteuse de
sa propre nature. On comprendra également qu’en présence
d’imbéciles et de fous il n’y a qu’une
seule manière
de montrer qu’on a de la raison : c’est de ne pas parler
avec eux. Mais il est vrai qu’alors, en société, maint homme
pourra se trouver dans la situation d’un danseur, entrant dans un
bal où il n’y aurait que des perclus ; avec qui
dansera-t-il ? »
« La
plupart des hommes sont tellement personnels qu’au fond rien n’a
d’intérêt à leurs yeux qu’eux-mêmes et exclusivement eux. Il
en résulte que, quoi que ce soit dont on parle, ils pensent aussitôt
à eux-mêmes, et que tout ce qui, par hasard et du plus loin que ce
soit, se rapporte à quelque chose qui les touche, attire et captive
tellement toute leur attention qu’ils n’ont plus la liberté de
saisir la partie objective de l’entretien ; de même, il n’y
a pas de raisons valables pour eux dès qu’elles contrarient leur
intérêt ou leur vanité. Aussi sont-ils si facilement distraits, si
facilement blessés, offensés ou affligés que, lors même qu’on
cause avec eux, à un point de vue objectif, sur n’importe quelle
matière, on ne saurait assez se garder de tout ce qui pourrait, dans
le discours, avoir un rapport possible, peut-être fâcheux avec le
précieux et délicat moi que
l’on a devant soi ; rien que ce moi ne les intéresse, et,
pendant qu’ils n’ont ni sens ni sentiment pour ce qu’il y a de
vrai et de juste, ou de beau, de fin, de spirituel dans les paroles
d’autrui, ils possèdent la plus délicate sensibilité pour tout
ce qui, du plus loin et le plus indirectement, peut toucher leur
mesquine vanité ou se rapporter désavantageusement, en quelque
façon que ce soit, à leur inappréciable moi. Ils ressemblent, dans
leur susceptibilité, à ces roquets auxquels on est si facilement
exposé, par mégarde, à marcher sur la patte et dont il faut subir
ensuite les piailleries ; ou bien encore à un malade couvert de
plaies et de meurtrissures et qu’il faut éviter soigneusement de
toucher. Il y en a chez qui la chose est poussée si loin, qu’ils
ressentent exactement comme une offense l’esprit et le jugement que
l’on montre, ou qu’on ne dissimule pas suffisamment, en causant
avec eux ; ils s’en cachent, il est vrai, au premier moment,
mais ensuite celui qui n’a pas assez d’expérience réfléchira
et se creusera vainement la cervelle pour savoir par quoi il a pu
s’attirer leur rancune et leur haine. Mais il est tout aussi facile
de les flatter et de les gagner. Par suite, leur sentence est,
d’ordinaire, achetée : elle n’est qu’un arrêt en faveur
de leur parti ou de leur classe et non un jugement objectif et
impartial. Cela vient de ce que chez eux la volonté surpasse de
beaucoup l’intelligence et de ce que leur faible intellect est
entièrement soumis au service de la volonté dont il ne peut
s’affranchir un seul moment. »
« Les
gens d’une espèce plus noble et doués de facultés plus élevées
trahissent, principalement dans leur jeunesse, un manque surprenant
de connaissance des hommes et de savoir-faire ; ils se laissent
ainsi facilement tromper ou égarer ; tandis que les natures
inférieures savent bien mieux et bien plus vite se tirer d’affaire
dans le monde ; cela vient de ce que, à défaut d’expérience,
l’on doit juger a
priori et
qu’en général aucune expérience ne vaut l’a
priori.
Chez les gens de calibre ordinaire, cet a
priori leur
est fourni par leur propre moi,
tandis qu’il ne l’est pas à ceux de nature noble et distinguée,
car c’est par là précisément que ceux-ci diffèrent des autres.
En évaluant donc les pensées et les actes des hommes ordinaires
d’après les leurs propres, le calcul se trouve être faux.
Mais
même alors qu’un tel homme aura appris enfin a
posteriori,
c’est-à-dire par les leçons d’autrui et par sa propre
expérience, ce qu’il y a à attendre des hommes ; même alors
qu’il aura compris que les cinq sixièmes d’entre eux sont ainsi
faits, moralement et intellectuellement, que celui qui n’est pas
forcé par les circonstances d’être en relation avec eux fait
mieux de les éviter dès l’abord et de se tenir autant que
possible hors de leur contact, même alors cet homme ne pourra,
presque jamais, avoir une connaissance suffisante de
leur petitesse et de leur mesquinerie ; il aura durant toute sa
vie à étendre et à compléter cette notion ; mais jusqu’alors
il fera encore bien des faux calculs à son détriment. Et ensuite,
bien que pénétré des enseignements reçus, il lui arrivera encore
parfois, se trouvant dans une société de gens qu’il ne connaît
pas encore, d’être émerveillé en les voyant tous paraître, dans
leurs discours et dans leurs manières, entièrement raisonnables,
loyaux, sincères, honnêtes et vertueux, et peut-être bien aussi
intelligents et spirituels. Mais que cela ne l’égare pas ;
cela provient tout simplement de ce que la nature ne fait pas comme
les méchants poètes, qui, lorsqu’ils ont à présenter un coquin
ou un fou, s’y prennent si lourdement et avec une intention si
accentuée que l’on voit paraître pour ainsi dire derrière chacun
de ces personnages l’auteur désavouant constamment leur caractère
et leurs discours et disant à haute voix et en manière
d’avertissement : « Celui-ci est un coquin, cet autre un
fou ; n’ajoutez pas foi à ce qu’il dit. » La nature
au contraire s’y prend à la façon de Shakespeare et de Goethe :
dans leurs ouvrages, chaque personnage, fût-il le diable lui-même,
tant qu’il est en scène et parle, a raison dans ce qu’il dit ;
il est conçu d’une manière si objectivement réelle qu’il nous
attire et nous force à prendre part à ses intérêts ; pareil
aux créations de la nature, il est le développement d’un principe
intérieur en vertu duquel ses discours et ses actes apparaissent
comme naturels et par conséquent comme nécessaires. Donc celui qui
croit que dans le monde les diables ne vont jamais sans cornes et les
fous sans grelots sera toujours leur proie ou leur jouet. Ajoutons
encore à tout cela que, dans leurs relations, les gens font comme la
lune et les bossus, c’est-à-dire qu’ils ne nous montrent jamais
qu’une face ; ils ont même un talent inné pour transformer
leur visage, par une mimique habile, en un masque représentent très
exactement ce
qu’ils devraient être en
réalité ; ce masque, découpé exclusivement à la mesure de
leur individualité, s’adapte et s’ajuste si bien que l’illusion
est complète. Chacun se l’applique toutes les fois qu’il s’agit
de se faire bien venir. Il ne faut pas plus s’y lier qu’a un
masque de toile cirée, et rappelons-nous cet excellent proverbe
italien : « Non
è si tristo cane, che non meni la coda »
(Il n’est si méchant chien qui ne remue la queue). »
« Comme
il faut être novice pour croire que montrer de l’esprit et de la
raison est un moyen de se faire bien voir dans la société !
Bien au contraire, cela éveille chez la plupart des gens un
sentiment de haine et de rancune, d’autant plus amer que celui qui
l’éprouve n’est pas autorisé à en déclarer le motif ;
bien plus, il se le dissimule à lui-même. Voici en détail comment
cela se passe : de deux interlocuteurs, dès que l’un remarque
et constate une grande supériorité chez l’autre, il en conclut
tacitement, et sans en avoir la conscience bien exacte, que cet autre
remarque et constate au même degré l’infériorité et l’esprit
borné du premier. Cette conclusion excite sa haine, sa rancune, sa
rage la plus amère. Aussi Gracian dit-il avec raison : « Para
ser bien quisto, el unico medio vestirse la piel del mas simple
de los brutos » (Pour
être bien tranquille, le seul moyen est de revêtir la peau du plus
simple des animaux). Mettre au jour de l’esprit et du jugement,
n’est-ce pas une manière détournée de reprocher aux autres leur
incapacité et leur bêtise? De plus, une nature vulgaire se révolte
à l’aspect d’une nature opposée ; le fauteur secret de la
révolte, c’est l’envie. Car satisfaire sa vanité est, ainsi
qu’on peut le voir à tout moment, une jouissance qui, chez les
hommes, passe avant toute autre, mais qui n’est possible qu’en
vertu d’une comparaison entre eux-mêmes et les autres. Mais il
n’est pas de mérites dont ils soient plus fiers que de ceux de
l’intelligence, vu que c’est sur ceux-là que se fonde leur
supériorité à l’égard des animaux. Il est donc de la plus
grande témérité de leur montrer une supériorité intellectuelle
marquée, surtout devant témoins. Cela provoque leur vengeance, et
d’ordinaire ils chercheront à l’exercer par des injures, car ils
passent ainsi du domaine de l’intelligence à celui de la volonté,
sur lequel nous sommes tous égaux. Si donc la position et la
richesse peuvent toujours compter sur la considération dans la
société, les qualités intellectuelles ne doivent nullement s’y
attendre ; dans le cas le plus favorable, on les ignore ;
mais, autrement, on les envisage comme une espèce d’impertinence,
ou comme un bien que son propriétaire a acquis par des voies
illicites et dont il a l’audace de se targuer ; aussi chacun
se propose-t-il en silence de lui infliger ultérieurement quelque
humiliation dans un autre domaine, et l’on n’attend pour cela
qu’une occasion favorable. C’est à peine si, par une attitude
des plus humbles, on réussira à arracher le pardon de sa
supériorité d’esprit, comme on arrache une aumône. Saadi dit
dans le Gulistan : « Sachez
qu’il se trouve chez l’homme irraisonnable cent fois plus
d’aversion pour le raisonnable que celui-ci n’en ressent pour le
premier. »
Par contre, l’infériorité intellectuelle équivaut à un
véritable titre de recommandation. Car le sentiment bienfaisant de
la supériorité est pour l’esprit ce que la chaleur est pour le
corps ; chacun se rapproche de l’individu qui lui procure
cette sensation, par le même instinct qui le pousse à s’approcher
du poêle ou à aller se mettre au soleil. Or il n’y a pour cela
uniquement que l’être décidément inférieur, en facultés
intellectuelles pour les hommes, en beauté pour les femmes. Il faut
avouer que, pour laisser paraître de l’infériorité non simulée,
en présence de bien des gens, il faut en posséder une dose
respectable. En revanche, voyez avec quelle cordiale amabilité une
jeune fille médiocrement jolie va à la rencontre de celle qui est
foncièrement laide. Le sexe masculin n’attache pas grande valeur
aux avantages physiques, bien que l’on préfère se trouver à côté
d’un plus petit que d’un plus grand que soi. En conséquence,
parmi les hommes, ce sont les bêtes et les ignorants qui sont en
faveur et recherchés partout ; parmi les femmes, les laides ;
on leur fait immédiatement la réputation d’avoir un cœur
excellent, vu que chacun a besoin d’un prétexte pour justifier sa
sympathie, à ses yeux et à ceux des autres. Pour cette raison,
toute supériorité d’esprit a la propriété d’isoler : on la
fuit, on la hait, et pour avoir un prétexte on prête à celui qui
la possède des défauts de toute sorte. »
Laurent
Gané
▶ Commandez sur Amazon :
▶ Commandez sur Amazon :
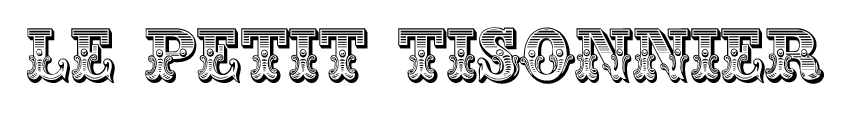

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire